«Les associations comme Caritas ont un rôle fondamental en Suisse»
10 avril 2025 | Lecture 11 min.

À la tête du Département fédéral de l'intérieur depuis janvier 2024, la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider enchaîne les prises de position sur des sujets sociaux et de santé publique. Parmi eux, la précarité d'une partie de la population suisse qui ne fait pas appel aux aides sociales disponibles. Interview.
Caritas: Vous êtes assistante sociale de formation, depuis quand avez-vous éprouvé le besoin d'aider les autres?
Elisabeth Baume-Schneider: Depuis toujours, il me semble. J'ai eu la chance de naître dans une famille paysanne où on se préoccupait les uns des autres. À l'époque, nous avions des ouvriers saisonniers. Ils devaient travailler loin de leurs familles pour pouvoir vivre, cela me questionnait. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait là de l'injustice. S'intéresser aux autres, c'était surtout essayer de faire que les choses soient plus justes. Non pas pour que tout le monde ait exactement la même chose, mais pour que tout le monde trouve sa place.
J'ai eu la chance de naître dans une famille paysanne où on se préoccupait les uns des autres.
Ma sœur et moi passions beaucoup de temps avec les ouvriers agricoles. Ils m’ont par exemple appris à jouer aux échecs. Prendre conscience des difficultés des personnes, c'est aussi et surtout reconnaitre leurs potentialités et prendre en considération leur expertise. Ne pas affirmer «certains savent, d'autres pas», mais plutôt réfléchir à comment entrer en relation pour que les rencontres entre les uns et les autres soient fertiles de part et d’autre.
La pauvreté vous touche donc depuis longtemps, avez-vous quelques exemples d'actions réalisées en ce domaine dans vos différentes activités?
En tant qu'assistante sociale, mon premier métier, j'essayais toujours de trouver un peu d'argent supplémentaire pour compléter le budget d'assistance sociale des bénéficiaires. Un jour, un député jurassien m'a dit que ces personnes vivaient dans «une marginalité dorée», pour reprendre ses mots. Or l'aide sociale est tout sauf une «marginalité dorée»! Ce sont des budgets extrêmement modestes qui, corrélés au minimum vital, permettent juste de vivre.
Ensuite, en tant que députée jurassienne, je me souviens de m'être préoccupée des chômeurs qui ne touchaient pas d'allocation de naissance, puis en tant que ministre, des questions d'inégalités pour les enfants confrontés à des difficultés en milieu scolaire. Il ne s’agit pas ici de pauvreté économique, mais du risque de stigmatisation.
S'intéresser aux autres, c'est surtout essayer de faire que les choses soient plus justes.
En tant que directrice de la Haute École de travail social à Lausanne, j’ai pu ensuite accompagner la mise en place de projets de formation continue et de recherche sur ce sujet. Et cela continue dans le cadre de mes fonctions actuelles. Je suis par exemple de très près les interventions de la conseillère nationale Estelle Revaz qui a déposé une motion pour la mise en place d’une plateforme nationale de prévention contre la pauvretéLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet..
Parmi les nombreux projets contre la pauvreté, lequel vous donne le plus de fierté?
Ce n’est peut-être pas le projet dont je suis le plus fière, mais je le trouve très, très beau: il s'appelle «Au P'tit plusLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet.». C'est une épicerie solidaire aux Franches-Montagnes qui répond très concrètement aux difficultés financières des gens, de manière très respectueuse. Une soixantaine de bénévoles y travaillent à tour de rôle pour mettre à disposition des invendus triés chaque jour pour des clients venant acheter ce qui leur est nécessaire, pour 1 franc symbolique.
En matière d'aide sociale, il y a bien sûr la nécessité de pouvoir compter sur des professionnel-le-s mais il ne faut pas négliger toutes ces personnes qui s'engagent dans des actions de proximité. Ce que chacun fait en tant que bénévole ou comme citoyenne ou citoyen engagé-e est essentiel et contribue à la dignité de chacune et de chacun.
Lors de la campagne pour la 13e rente AVS, vous avez mis en avant le fait que les prestations complémentaires pouvaient aider les seniors dans une situation précaire. Mais en fait ce sont les personnes âgées en majorité qui n'osent pas demander de l'aide. Comment éviter ce non-recours?
C'est une compétence des cantons, mais je pense qu'on pourrait rappeler au niveau fédéral l'importance de développer une information de qualité, accessible et non stigmatisante. À une époque, dans le canton du Jura, il y avait un calculateur à la fin de la déclaration d'impôts qui permettait de savoir si on avait droit aux prestations complémentaires (PC). Les possibilités existent donc au niveau fiscal, pour rendre les choses plus simples et plus visibles.
Ceci étant dit, il faut également prendre en considération que si les PC, à l’instar des autres prestations sociales, sont un droit, celui-ci implique aussi des contreparties. J'ai reçu passablement de courriers de personnes qui ressentaient les démarches nécessaires comme intrusives, voire comme une humiliation. Or il s'agit d'argent public. C’est comme quand on demande une bourse pour étudier, il faut donner quelques explications, fournir des pièces justificatives pour documenter sa demande. C'est plutôt la manière dont les personnes se sentent contrôlées qui doit être améliorée. Il faut améliorer les processus pour désamorcer ce sentiment de honte.

Notre Constitution indique que chacune et chacun a droit à une vie dans la dignité.
Comment selon vous convaincre qu'il n'y a rien de honteux à demander de l'aide?
Quand on est à l'aide sociale, ou qu’on bénéficie de prestations sociales, on ne s’expose pas volontiers et on ne s’identifie guère à un groupe. À ma connaissance, il n'y a pas une association de bénéficiaires de l'aide sociale qui pourraient témoigner du fait qu'être aidé, c'est être reconnu et soutenu pour être en mesure de choisir son propre chemin de vie.
Il faut améliorer les processus pour désamorcer ce sentiment de honte.
Je pense qu'il faut lutter contre la pauvreté, afin que les personnes en situation de précarité puissent retrouver l’autonomie et l’estime de soi et se projeter dans leur projet de vie. Bref, simplement être des citoyens libres de prendre leurs décisions, et en bonne santé pour participer au marché du travail, à la vie sociale et culturelle, en étant reconnus pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils apportent à la société.
En juin dernier, votre canton, le Jura, a déposé une initiative pour rendre les prestations complémentaires plus accessibles, et plusieurs motions vont également dans ce sens. Une étude émanant de la Confédération devait être engagée pour évaluer les procédures existantes: où en est-on de cette étude, et que pensez-vous de la démarche de votre canton?
Je pense que l'initiative du canton du Jura est très pertinente, et je ne dis pas cela parce que c'est mon canton! Quant à l'étude, si on veut essayer de faire évoluer les mentalités ou la manière de percevoir les choses, il faut qu'on ait des indications qualitatives sur la manière dont on les présente. L'étude en question va s'achever cet automne. Ce que je trouve important, c'est d'évaluer les bonnes pratiques et de savoir quels peuvent être les incitatifs positifs ou négatifs; quels sont les éléments qui freinent l'accès?
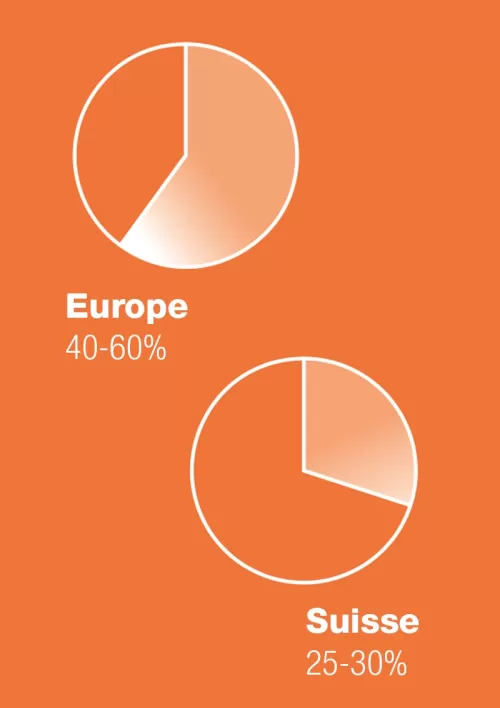
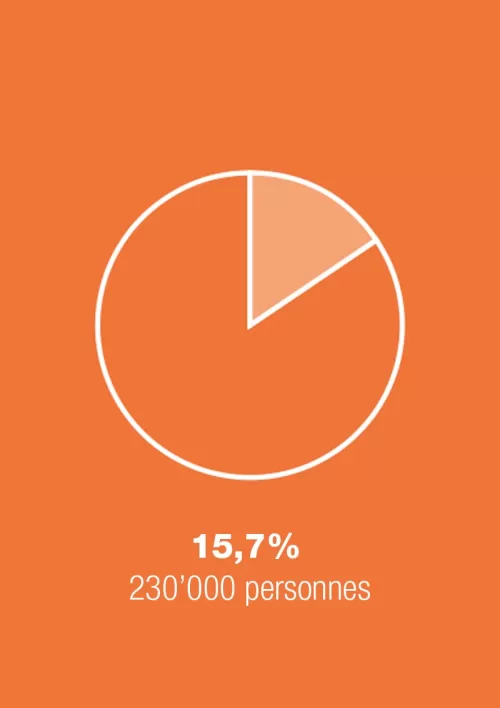
En juin dernier, le canton du Jura a également fait une campagne pour montrer comment accéder à une plateforme d'information sociale, intitulée JU-lien.orgLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet.. Elle a eu des échos favorables auprès de la population et les personnes qui en avaient besoin l'ont utilisée. Il faudrait pouvoir investir dans de telles campagnes, parce que faire l’effort une fois ne suffit pas. Reste l’essentiel: cette campagne a démontré que quand on informe, quand on dédramatise le fait de demander un soutien, des personnes osent solliciter l'aide à laquelle elles ont droit.
Que pensez-vous d'une campagne nationale contre le non-recours aux prestations sociales?
Notre Constitution indique que chacune et chacun a droit à une vie dans la dignité; son préambule précise encore que le «la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres». L'aide sociale fait partie de ce maillage social. Elle est un droit. Une campagne nationale d'information contre le non-recours aux prestations sociales pourrait être envisagée, mais il faudrait réfléchir avant tout à comment informer les personnes concernées. Il est important d’atteindre celles et ceux qui sont peu enclins à faire confiance aux autorités, ou qui n'ont pas envie de solliciter l'aide sociale. Certains redoutent une trop forte intrusion dans leur manière de vivre, d’autres – comme les personnes âgées – craignent par exemple qu'on leur prenne la petite maison qu'elles ont mis des années à acquérir en travaillant.
Quand on informe, et dédramatise le fait de demander un soutien, des personnes osent solliciter l'aide à laquelle elles ont droit.
L'information pourrait passer par le biais des pairs, qu’on trouve par exemple dans des lieux comme la petite épicerie solidaire dont j'ai parlé. Quand j'étais directrice de la Haute École de travail social à Lausanne, j’ai accompagné le développement d'un projet pilote de calculateur d'aide sociale (jestime.chLe lien s'ouvre dans un nouvel onglet.). La Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) était intéressée à cet outil, mais il fallait prendre en compte les différentes normes des cantons; certains ont redouté que ce calculateur engendre une forte augmentation des demandes, jusqu’à surcharger leurs services.
Vous souhaitez un conseil social?
Gratuit et en toute confidentialité
Demandez maintenant une consultation
Pour ma part, je trouvais le projet intéressant, car ces calculateurs auraient dû se trouver dans des lieux où vont les personnes en difficulté. On a constaté qu'il est difficile de réunir tous les cantons autour d'un tel projet, mais une campagne d'information pourrait être coordonnée au niveau de la plateforme nationale contre la pauvreté, comme faisant partie des mesures à prendre. Après, il faudrait trouver une solution pour le financer, par exemple avec une participation des cantons et des villes.
Avez-vous d'autres projets sociaux qui vous tiennent à cœur?
Il faut absolument éviter de discriminer un type de population comme les personnes issues de la migration. Récemment, une initiative parlementaire de la députée bâloise Samira Marti a été acceptée. Elle empêche notamment que des étrangers se voient retirer leur autorisation de séjour et d'établissement au motif qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale. Quand les cantons ou les communes veulent agir de manière plus solidaire ou humaniste, ils peuvent le faire. C'est une question de majorité-minorité. Il y aurait encore d'autres projets concernant les questions de genre ou d'égalité qui me tiennent à cœur! En fait, il faut oser dire les choses et s’engager si on ne veut pas que certaines de nos valeurs démocratiques partent en lambeaux.
Il faut oser dire les choses et s’engager si on ne veut pas que certaines de nos valeurs démocratiques partent en lambeaux.
Enfin, que pensez-vous des associations d'aide comme Caritas qui luttent contre la précarité?
Leur rôle dans un pays comme la Suisse est fondamental. Elles sont un peu comme des sismographes qui mesurent des valeurs réelles, en contact avec les personnes. Dans l'idéal, il serait évidemment mieux que Caritas, le CSP (Centre social protestant) ou d'autres associations soient moins sollicitées et que les «canaux» plus officiels suffisent.
Disons que c'est un peu interpellant que dans un pays riche et démocratique comme le nôtre, on ait autant besoin d’associations comme Caritas et de leurs réseaux de professionnels et de bénévoles. Leur rôle est subsidiaire, mais pour de trop nombreuses personnes, il est essentiel pour leur assurer une qualité de vie à laquelle chaque être humain peut prétendre. Ma grande reconnaissance va à ces partenaires et aux personnes qui les sollicitent pour la confiance qu’ils leur portent.
Cet article est paru dans le «Caritas.mag». Le magazine des organisations Caritas régionales paraît deux fois par an.
Découvrir maintenant


